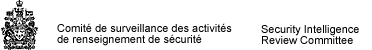CSARS Rapport annuel 2011–2012 : Relever le défi
Regard sur l’avenir dans un paysage en mutation
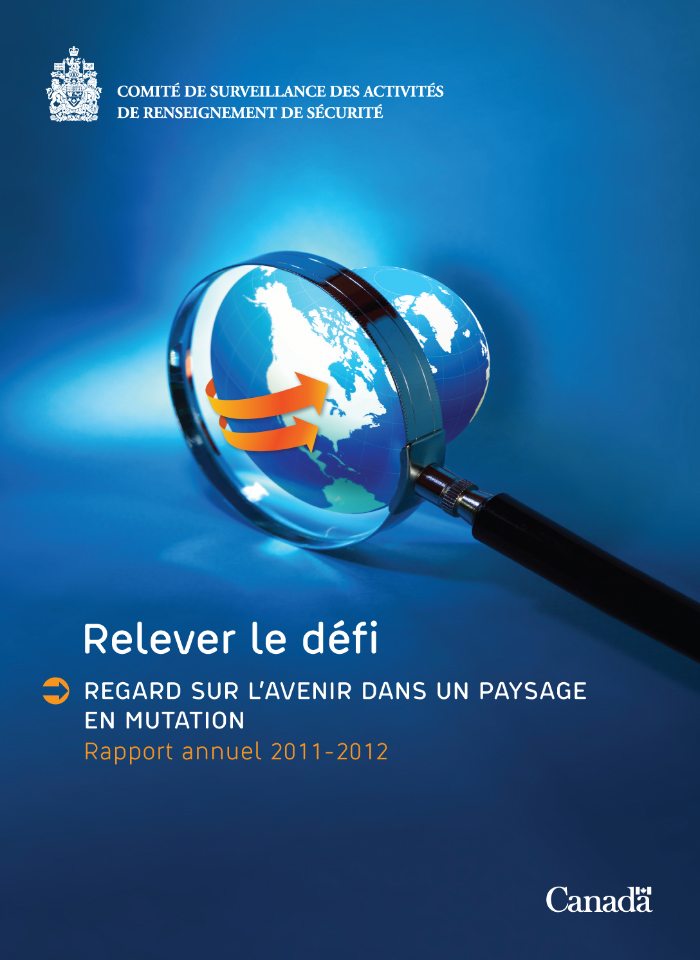
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
B.P. 2430, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 5W5
© Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2012
Numéro de catalogue PS 105-2012
ISSN 1921–0566
Le 30 septembre 2012
Ministre de la Sécurité publique
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur le Ministre,
C’est pour nous un plaisir de vous remettre le rapport annuel du Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité pour l’exercice 2011–2012, tel qu’il est prescrit à l’article 53 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, afin qu’il soit transmis au Parlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Chuck Strahl, C.P.
Président
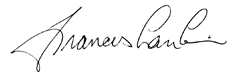
Frances Lankin, C.P., C.M.
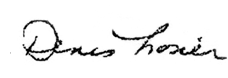
Denis Losier, C.P., C.M.
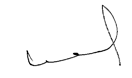
Philippe Couillard, C.P., M.D.
À propos du CSARS
Le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS ou Comité) est un organisme indépendant qui rend compte des opérations du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS ou Service) au Parlement du Canada. Le CSARS effectue des études sur les activités du SCRS et enquête sur les plaintes du public contre le Service. Cela lui permet de fournir au Parlement, et à tous les citoyens du Canada, l’assurance que le Service enquête sur les menaces à la sécurité nationale et fait rapport à ce sujet d’une façon qui respecte la primauté du droit et les droits des Canadiens. Pour plus de renseignements sur le CSARS, veuillez consulter www.sirc-csars.gc.ca sur l’Internet.
À propos du SCRS
Le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a charge d’enquêter sur les menaces contre le Canada, d’analyser l’information et de produire des renseignements.
Pour protéger le Canada et ses citoyens, le SCRS conseille le gouvernement fédéral au sujet des questions et activités qui menacent ou peuvent menacer la sécurité nationale, notamment le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, l’espionnage et les activités d’instigation étrangère.
Le SCRS effectue également des évaluations de sécurité individuelles pour le compte de tous les ministères et organismes fédéraux, sauf la Gendarmerie royale du Canada.
Cadre juridique à la fois pour le CSARS et le SCRS
Par suite de l’adoption de la Loi sur le SCRS, le Canada est devenu l’un des premiers pays démocratiques du monde entier à doter son service de sécurité d’un cadre juridique. Cette loi a clairement défini le mandat et les limites du pouvoir de l’État en matière de renseignement de sécurité. Par ailleurs, elle a créé des mécanismes de reddition de comptes qui permettent de contrôler ce pouvoir considérable.
Table des matières
- Message des membres du comité
- À propos du présent rapport
- Section 1. Bilan de l’exercice
- Section 2. Résumés des études du CSARS et des plaintes
- A. Études
- Le rôle du SCRS à l’égard du Programme de protection des passagers
- Le rôle du SCRS dans le processus d’attestation de danger pour la sécurité
- Le rôle du SCRS dans une enquête sur la lutte contre la prolifération
- La radicalisation d’origine intérieure
- L’appui du SCRS à l’égard des dossiers nouveaux et des priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement
- Un poste du SCRS à l’étranger
- Les relations du SCRS avec un partenaire étranger
- Élaboration et diffusion de produits du renseignement par le SCRS
- B. Plaintes
- A. Études
- Section 3. Survol du CSARS
Message des membres du Comité
Depuis près de 30 ans, le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS) a servi de contrepoids essentiel aux pouvoirs extraordinaires dont le Parlement a investi le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).
Cette année, nous avons à nouveau le plaisir de présenter notre rapport annuel au Parlement, et par son entremise à la population du Canada. Ce rapport résume les travaux du Comité au cours du dernier exercice et fournit autant de détails que la loi nous permet d’en divulguer. Il contient les résumés des huit études approfondies qui ont été effectuées cette année sur des activités, enquêtes et programmes particuliers du SCRS ainsi que les résumés des dossiers de plaintes réglés au fil de l’exercice. De plus, comme nous l’avons fait dans les rapports antérieurs, nous avons inclus dans celui-ci certaines statistiques opérationnelles ayant trait aux enquêtes du SCRS.
Cette année, le travail du CSARS s’est poursuivi à un rythme soutenu et productif. Au cours des trois dernières années, nous avions formulé quelque 30 recommandations visant non seulement à ce que le Service respecte la loi, attente que nous estimons minimale, mais aussi, ce qui est encore plus important, à ce qu’il améliore son rendement et son efficacité. Nous vérifions si le SCRS met en œuvre nos recommandations et dans quelle mesure il le fait, et cela, non pas parce que c’est notre travail d’orienter le Service, mais parce qu’il nous faut savoir si nous exerçons l’influence positive que le Parlement avait entrevue pour nous. Nos recherches ont montré que, par le passé, le SCRS a donné suite, en tout ou en partie, à environ 70 % des recommandations du CSARS, ce qui dénote l’efficacité du rôle de notre organisme et l’utilité de ses analyses et de ses recommandations pour le Service, à notre avis.
Le lecteur du présent rapport sait déjà que le régime établi en 1984 pour assurer la reddition de comptes du SCRS a subi récemment quelques changements importants. En juin 2012, le Parlement a confié au CSARS certaines responsabilités jusque-là dévolues à l’inspecteur général du SCRS. À compter du prochain exercice financier, le CSARS aura charge d’évaluer et de certifier le rapport annuel présenté au Ministre par le directeur du SCRS, contribuant par là à assurer la responsabilité ministérielle pour le SCRS et la reddition de comptes de cet organisme au Ministre. C’est donc dire que le CSARS a une tâche importante à assumer, ce qui est une occasion de choix, à nos yeux. Au cours des années antérieures, nous avons été témoins à la fois de la coopération et de la coordination entre le CSARS et l’inspecteur général du SCRS pour ce qui est d’assurer la couverture optimale des activités du SCRS et de partager des pratiques exemplaires. Confier au CSARS la responsabilité de certaines tâches de l’inspecteur général du SCRS permettra à une entité experte unique de produire à la fois des rapports pour l’ensemble du Parlement et un produit destiné de façon spéciale au Ministre. De notre point de vue, le plus grand défi consistera à préserver l’indépendance qui est au cœur de notre mandat principal tout en répondant aux attentes nouvelles du gouvernement.
Les paramètres juridiques qui sont fixés pour le fonctionnement du CSARS et du SCRS ont aussi évolué. Il convient de signaler en particulier que la Cour fédérale a rendu récemment deux décisions qui concernent le processus des plaintes du CSARS et le valident. Dans une décision rendue par le juge Simon Noël, la Cour a statué que le CSARS a compétence pour entendre les plaintes au sujet d’actions du SCRS donnant lieu à des violations présumées de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon cet arrêt, les plaintes portées au CSARS pour violation présumée de la Charte feront désormais partie intégrante des enquêtes du Comité. Comme l’a déclaré la Cour fédérale, les enquêtes du CSARS sur les violations de la Charte avaient toujours été envisagées initialement dans la Loi sur le SCRS, et le Comité se félicite des éclaircissements que fournit cet arrêt. Dans une autre décision rendue par le juge Noël, la Cour fédérale a établi qu’elle pourrait effectivement examiner les rapports de plaintes portées en vertu de l’article 41, confirmant ainsi la position du CSARS. Cet arrêt renforce la reddition de comptes du CSARS du fait de la surveillance judiciaire tout en faisant ressortir l’importance de notre processus pour les plaignants.
L’an dernier, le Comité a proposé un régime visant à donner suite aux recommandations du juge Dennis O’Connor qui réclamait un examen de toutes les activités liées à la sécurité nationale à l’échelle du gouvernement. Selon notre proposition, en modulant légèrement le mandat du CSARS et en modifiant en conséquence la Loi sur le SCRS, le CSARS pourrait examiner et évaluer les questions de sécurité nationale qui mettent en cause le SCRS mais débordent le cadre strict de cet organisme. Par exemple, le CSARS a noté avec intérêt les points soulevés dans le rapport annuel du Bureau du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (CST). L’an dernier, le CSARS a rencontré le Commissaire pour discuter de l’élargissement des relations entre le CST et le SCRS et il lui a fait part de son intention que la collaboration entre le CST et le SCRS devienne l’un des axes de travail prioritaires du CSARS pour le cycle de surveillance 2012–2013. À ce jour, le CSARS attend les orientations du gouvernement quant à une modification possible de sa capacité de surveillance, ce qui nécessiterait un ajustement correspondant de ses ressources.
Enfin, la composition du Comité a aussi subi d’importants changements au cours du dernier exercice. Nous avons accueilli récemment un nouveau président, l’honorable Chuck Strahl, C.P., dont la réputation d’intégrité, d’engagement et d’équité le précède depuis longtemps. Les membres du CSARS entrevoient une collaboration fructueuse sous la direction de M. Strahl. Le Comité souhaite aussi rendre hommage à deux anciens présidents, l’honorable Arthur Porter, C.P., M.D., et l’honorable Carol Skelton, C.P. Nous les remercions tous les deux de leur apport aux travaux du CSARS.
La nomination de M. Strahl contribue à souligner une force fondamentale du modèle du CSARS. En qualité d’ancien ministre et de parlementaire, M. Strahl siège à un comité dont chaque membre jusqu’ici a été ministre et parlementaire. Ainsi, nous comptons des années d’expertise à soupeser l’intérêt public dans une vaste gamme de politiques et de programmes divers et pourtant, à titre de membres du CSARS, nous pouvons le faire à l’abri des préoccupations partisanes qui teintent la réalité quotidienne de ceux qui occupent encore une charge publique. Le Comité peut donc se fonder sur une grande variété de points de vue éclairés qui émanent de régions, d’horizons politiques et de domaines d’expertise multiples, tous réunis autour d’une même table non partisane.
Comme toujours, les membres du CSARS présentent les fruits de leur travail avec fierté et sont heureux de partager leurs constatations, recommandations et analyses à la fois avec le Parlement et avec toute la population du Canada. Nous espérons que, par ses travaux de 2011–2012, le Comité continuera de contribuer au débat en cours qui entoure la sécurité nationale, et le rôle essentiel de surveillance et de contrôle qu’il joue sur ce plan. Nous espérons aussi montrer l’importance fondamentale que revêt le rôle joué par le SCRS en vue de préserver la sécurité nationale au Canada ainsi que l’utilité et la fiabilité de la reddition de comptes qui est assurée par l’entremise du CSARS depuis 1984.
Les membres du Comité

L’honorable
Chuck Strahl

L’honorable
Denis Losier

L’honorable
Frances Lankin

L’honorable
Dr Philippe Couillard
À propos du présent rapport
Le mandat et les fonctions du CSARS sont définis dans la loi même qui établit le cadre juridique du Service, soit la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Conformément à cette loi, le CSARS prépare chaque année, au sujet de ses activités, un rapport annuel que le ministre de la Sécurité publique transmet au Parlement.
Le présent rapport annuel résume les principales analyses du CSARS ainsi que les constatations et recommandations qui découlent de ses études et de ses enquêtes sur les plaintes. Il compte trois sections :
Section 1 : Bilan de l’exercice
Analyse d’importants faits nouveaux, dans le domaine du renseignement de sécurité, et de leurs rapports avec certaines constatations et recommandations formulées par le CSARS pendant l’exercice précédent.
Section 2 : Résumés des études du CSARS et des plaintes
Résumés des études effectuées par le CSARS et des décisions qu’il a rendues au sujet de plaintes durant la période visée par le présent rapport.
Section 3 : Survol du CSARS
Exposé des activités du CSARS en matière d’intéressement du public et de liaison et sur le plan administratif. Comprend des détails sur son budget annuel et ses dépenses.
Renseignements généraux faciles à trouver, là où ils sont utiles
Reportez-vous aux encadrés tout au long du présent rapport annuel. Vous y trouverez de précieux renseignements généraux sur diverses questions juridiques et stratégiques ayant trait aux fonctions de surveillance et d’enquête du CSARS.
Section 1 : Bilan de l’exercice
Encore une fois, l’année qui vient de s’écouler s’est révélée ardue à la fois pour le SCRS et pour le CSARS. En effet, tous deux ont mis les bouchées doubles pour à la fois maintenir mais aussi améliorer leurs résultats et la production, en période d’austérité budgétaire croissante. Dans le cas du SCRS, cela l’a obligé à élaborer des outils perfectionnés de gestion du risque, à centraliser davantage l’analyse du renseignement et à élargir son champ d’action à de nouveaux domaines, et cela, avec efficacité et efficience. Quant au CSARS, cela l’a amené à adopter une approche plus thématique et horizontale afin d’examiner et de produire une série de documents et d’analyses, sur le cycle du renseignement du SCRS, du début à la fin, qui renforcent des recommandations et des observations antérieures du CSARS.
Dans tous ces cas, la gestion efficiente des ressources, la gestion efficace des risques et les avantages à miser sur les points forts actuels ont été des thèmes qui ont servi de balises aux deux organismes.
Conférence internationale des organismes de surveillance du renseignement
Pour tout organisme, il est vital de partager des pratiques exemplaires et de tirer parti de l’expérience de ses semblables, mais pour ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine de la sécurité nationale, les limites strictes de ce que nous pouvons divulguer, et de ceux à qui nous pouvons le faire, peuvent parfois donner le sentiment de travailler de façon isolée. Le dernier exercice s’est achevé sur les préparatifs finals du CSARS à la 8e Conférence internationale des organismes de surveillance du renseignement (CIOSR), de concert avec le Bureau du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications (BCCST). Cette conférence biennale permet aux délégués de plusieurs démocraties occidentales de partager leurs préoccupations, idées et pratiques exemplaires pour l’exercice de leurs responsabilités dans la reddition de comptes des services de renseignement de sécurité de leur pays. La conférence de cette année, tenue à Ottawa sous le thème « consolider la démocratie par une surveillance efficace », a réuni plus de soixante délégués de dix pays.
Chaque organisme représenté à la CIOSR a un mandat, une structure et des rapports hiérarchiques bien à lui, mais la conférence a fourni une occasion unique d’explorer des questions plus vastes qui touchent les organismes de surveillance et de contrôle. Nous avons découvert que les participants de tous les pays représentés se heurtent à des questions similaires, comme l’impact des décisions judiciaires et l’équilibre entre la sécurité nationale et les droits individuels ainsi que les difficultés des divers pays et services à échanger des informations.
Le CSARS et le BCCST se sont réjouis du succès de la Conférence, qui a accueilli une brochette de conférenciers représentant à la fois le monde universitaire, les médias, le milieu judiciaire et les gouvernements ainsi que d’anciens décideurs de haut rang de l’appareil canadien du renseignement. Depuis, le CSARS s’emploie à réunir un dossier contenant les actes de la conférence et des documents de planification à l’intention du pays qui accueillera la conférence en 2014.
Les études du CSARS
Certains propos tenus à la CIOSR ont également fait ressortir que beaucoup de pays vont bien au-delà des changements apportés par les événements du 11 septembre; à bien des égards, l’équilibre antérieur à ces événements dans la collecte de renseignements commence à se rétablir. À ses débuts, le SCRS employait la majeure partie de ses ressources à enquêter sur les réseaux d’espionnage. Depuis 2001, les activités liées à l’antiterrorisme ont largement supplanté le contre-espionnage. On voit cependant de nouveau poindre divers domaines nouveaux et émergents ainsi que le contre-espionnage et la lutte contre la prolifération d’armes.
Le CSARS est en position idéale pour cerner les changements récents, les relier aux tendances à long terme et assurer que le SCRS respecte son mandat dans la lutte aux divers types de menaces qui pèsent sur la sécurité nationale du Canada. Comme c’est le cas depuis 1984, le rapport annuel de cette année contient les résumés non classifiés d’une série complète d’études approfondies que le CSARS a effectuées au cours de l’exercice passé. Chaque étude est le fruit de recherches intensives menées pendant des mois par nos experts qui ont tous accès directement au personnel et à tous les documents du SCRS, à l’exception des documents confidentiels du Cabinet.
Selon deux études de cette année, le Service a entrepris de se positionner pour recueillir et analyser des informations de manière à répondre à l’attente grandissante du gouvernement du Canada de le voir jouer un rôle de « groupe de réflexion ». Le SCRS a placé sa direction des analyses au centre du processus de renseignement. Il s’écarte de la tendance que beaucoup lui prêtaient, soit « recueillir des informations pour lui-même », répondant plutôt aux besoins des clients de l’extérieur. Il peut néanmoins y avoir des limites à ce que le SCRS peut faire, tant sur le plan des ressources que dans l’optique de son mandat. Dans les pages qui suivent, le CSARS note que la volonté du SCRS d’élargir son savoir pour des clients de l’extérieur pourrait l’amener à recueillir des informations susceptibles d’outrepasser son mandat principal, le renseignement de sécurité, sinon à étendre sa capacité au-delà de ce qui est soutenable.
Un thème connu est aussi apparu dans plusieurs autres études cette année, soit les interactions avec les personnes d’âge mineur. Par suite du phénomène de la radicalisation d’origine intérieure, le SCRS a plus de chances d’entrer en rapport avec un nombre croissant de jeunes qui sont souvent la cible de tentatives de radicalisation, notamment quant au recrutement sur l’internet. Nous avons constaté que le SCRS avait élaboré des politiques concernant ses interactions directes auprès des mineurs, mais deux études du CSARS aboutissent néanmoins à la même conclusion : le Service doit se doter de mécanismes pour guider l’échange d’informations, en particulier avec les services étrangers, en ce qui touche les activités des mineurs.
« Le CSARS est en position idéale pour cerner les changements récents, les relier aux tendances à long terme et assurer que le SCRS respecte son mandat dans la lutte aux divers types de menaces qui pèsent sur la sécurité nationale du Canada. »
Une série d’enquêtes
La prolifération d’armes et les activités clandestines de gouvernements étrangers non seulement menacent la sécurité nationale, mais comptent aussi parmi les domaines de croissance qui seront les plus fertiles au cours des prochaines années. Ayant examiné ces menaces dans plusieurs études cette année, le CSARS note avec satisfaction que les stratégies du SCRS ont progressé dans la gestion du risque, ce qui renforce sa position dans le suivi des menaces à l’étranger. Cependant, le CSARS a fait valoir que, si le Service exerce davantage d’activités hors du pays, les risques potentiels seront plus nombreux et plus meurtriers et ne pourront être gérés pleinement ou atténués, et que le SCRS doit être prêt à en subir les conséquences.
Bien sûr, la menace du terrorisme demeure durable, mortelle et mondiale. Au cours des dernières années, comme cette année d’ailleurs, le CSARS a commenté le fait que le SCRS accroît sa présence et sa collecte de renseignements à l’étranger. Nos études comportaient presque toutes un volet international et, en raison de la coopération croissante avec divers partenaires étrangers, l’examen à la fois des échanges de renseignements et de la coopération avec des services étrangers entre régulièrement dans le processus de surveillance du CSARS. L’étude du CSARS sur un poste hors du pays a mis au jour des préoccupations quant à la documentation des échanges de renseignements du Service avec ses partenaires étrangers. Une étude distincte a soulevé des préoccupations à l’égard de ses pratiques en matière d’échange d’informations, notamment les procédures employées pour atténuer les dangers liés à ces échanges.
Et pourtant, de nouveaux dossiers attirent encore le SCRS en terrain neuf. Cette année, le CSARS a examiné le rôle joué par le Service dans des dossiers d’enlèvement et d’immigration clandestine, qui supposent une étroite collaboration avec des partenaires canadiens et étrangers dans les deux cas. Dans ces dossiers, les points forts traditionnels du SCRS, à savoir les réseaux de sources humaines et les liens puissants avec ses principaux partenaires étrangers, ont servi à conférer des rôles très utiles au Service. Le CSARS a toutefois noté que ces nouveaux dossiers exigeront à la fois de nouvelles ressources et de nouveaux domaines d’expertise, ce qui amènera à nouveau à retomber dans les pièges éventuels de la croissance rapide.
Conclusions
La surveillance des activités du SCRS par le CSARS met en lumière cette année le mouvement du SCRS vers des processus ou des initiatives qui vont au-delà de ce que beaucoup verraient comme son rôle « traditionnel », bien que ce mouvement puisse être perçu comme une réponse légitime à une demande de plus en plus forte du gouvernement. Cela dit, le CSARS est plus attentif que jamais à la possibilité que les partenaires du SCRS, au sein du gouvernement du Canada, exigent trop de sa part, et au risque qu’il s’éparpille par souci d’être efficace et efficient et de respecter les limites prévues par la loi.
De même, le CSARS doit relever le défi consistant à suivre le rythme du changement afin d’exercer un contrôle efficace. Cela requerra de sa part une intendance soigneuse et une attention de tous les instants afin de continuer d’offrir au Parlement l’analyse indépendante et experte que celui-ci en est venu à attendre de lui.
Section 2 : Résumés des études du CSARS et des plaintes
A. Études
Les études du CSARS visent à fournir au Parlement et à la population canadienne un tableau complet des activités du Service sur le plan opérationnel. Lorsqu’il effectue ses études, le CSARS examine la manière dont le SCRS s’est acquitté de ses fonctions afin de déterminer, après le fait, si celui-ci a agi d’une manière irréprochable et efficace et en tous points conforme à la loi.
Quelle différence y a-t-il entre un organisme de contrôle et un organisme de surveillance?
Un organisme de contrôle examine en permanence ce qui se passe au sein d’un service de renseignement et il a pour mandat d’en évaluer et guider ses actions courantes « en temps réel ». Le CSARS est un organisme de surveillance de sorte que, contrairement à un organisme de contrôle, il peut évaluer pleinement le rendement du SCRS sans avoir eu part à ses décisions opérationnelles et à ses activités, de quelque manière que ce soit.
Manière de conduire les études
Les études du CSARS fournissent un examen rétrospectif et une évaluation d’enquêtes et activités particulières du SCRS. Son programme de recherches est conçu de manière à englober un vaste éventail de sujets, et à le faire en temps utile et par thème.
Lorsqu’il détermine les sujets qu’il compte examiner, le CSARS prend en considération :
- les événements ou les faits nouveaux susceptibles de menacer la sécurité du Canada;
- les priorités établies par le gouvernement du Canada en matière de renseignement;
- les activités du SCRS qui pourraient avoir une incidence sur les droits et libertés individuels;
- les questions cernées par le CSARS dans le cadre de sa fonction relative aux plaintes;
- les nouvelles orientations et initiatives annoncées par le SCRS ou le touchant;
- le rapport annuel classifié que le directeur du SCRS présente au ministre de la Sécurité publique.
Chaque étude fournit un instantané des actions du Service dans un cas particulier. Cette approche permet au CSARS de gérer le risque que comporte sa capacité d’examiner seulement un petit nombre d’activités du SCRS une année donnée.
Pour en savoir plus à propos des études antérieures du CSARS
Au fil des ans, le CSARS a étudié un vaste éventail d’activités du SCRS. La liste complète des études antérieures du Comité figure sur son site Web (www.sirc-csars.gc.ca).
Les recherchistes du CSARS consultent de nombreuses sources d’information lorsqu’ils se penchent sur des aspects particuliers des travaux du Service. Dans le cadre de ce processus, ils peuvent organiser des séances d’information avec des employés du SCRS et étudier les dossiers d’enquête sur des individus et des groupes, les dossiers de sources humaines, les évaluations de renseignements et les documents joints aux demandes de mandats.
Le CSARS peut aussi examiner les dossiers ayant trait à la coopération et aux échanges opérationnels du SCRS avec des services et des partenaires étrangers et canadiens, entre autres sources, qui peuvent différer d’une étude à l’autre. L’idée de cette multiplicité de sources est que le CSARS puisse scruter un corpus d’informations assez varié pour avoir la certitude d’examiner et de comprendre à fond les dossiers en cause.
Les études du Comité contiennent des constatations et, s’il y a lieu, des recommandations. Elles sont remises au directeur du SCRS et à Sécurité publique Canada.
La reddition de comptes a de l’importance
Le CSARS est l’un des divers mécanismes qui visent à assurer la reddition de comptes au sujet du SCRS. Celui-ci doit aussi rendre compte de ses opérations par l’entremise du ministre de la Sécurité publique, des tribunaux, des organismes centraux du gouvernement (p. ex. le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor), du vérificateur général du Canada ainsi que des commissaires à l’information et à la protection de la vie privée du Canada.
Suivi des recommandations du CSARS
Chaque année, le CSARS demande au SCRS un rapport indiquant où il en est par rapport aux recommandations formulées dans les études et les décisions prises à l’égard de plaintes pendant l’exercice précédent. Ce rapport lui permet d’assurer un suivi de la mise en œuvre de ses recommandations et d’en vérifier les effets concrets sur le SCRS.
Ce processus fournit aussi au SCRS l’occasion de répondre officiellement aux études et aux décisions du CSARS et il s’inscrit dans le dialogue constant entre les deux organismes. Au cours de la période d’étude de 2010–2011, le CSARS a formulé onze recommandations portant sur un vaste éventail de questions.
Le CSARS note avec satisfaction que le SCRS a donné suite à plusieurs de ces recommandations. Ainsi, celle de 2010–2011 visant à rendre plus rigoureuse la validation des sources humaines a donné lieu à une révision de la politique existante. De même, sa recommandation visant à instaurer à l’échelle du Service une stratégie sur la gestion des relations avec le secteur privé a amené la haute direction à énoncer des orientations destinées à guider les bureaux régionaux du SCRS à l’égard de ces initiatives de liaison.
Étude du CSARS : Le rôle du SCRS à l’égard du Programme de protection des passagers
Depuis les événements du 11 septembre, la sûreté du transport aérien a pris de l’importance en ce qui touche la sécurité nationale. Les divers pays du monde ont donc été contraints de s’engager à améliorer et à renforcer leurs programmes et processus visant à assurer la sûreté de l’aviation.
Au Canada, l’un des éléments dominants de l’approche gouvernementale en matière de sûreté de l’aviation a été la mise en œuvre du Programme de protection des passagers (PPP). Ce programme englobe la Liste des personnes précisées (LPP), ou « liste des personnes interdites de vol », qui a été mise en œuvre en juin 2007 en vertu de la Loi sur l’aéronautique et s’apparente aux listes d’autres pays qui cherchent à améliorer la sûreté de l’aviation.
Le PPP vise à identifier les personnes susceptibles de représenter une menace pour la sûreté aérienne ou de nuire au transport aérien, et à prendre des mesures pour contrer cette menace et empêcher ces gens de monter à bord d’aéronefs.
Étude du CSARS
L’étude du CSARS a porté sur la participation du SCRS au PPP. Les activités du Service à cet égard consistent principalement à désigner les personnes qu’il estime justifié d’inscrire sur la LPP. Les désignations sont examinées par un groupe consultatif que préside Sécurité publique Canada et qui comprend le SCRS, la GRC, Transports Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et Justice Canada. Si le groupe appuie les désignations, elles sont soumises au ministre de la Sécurité publique qui prend la décision finale quant à l’inscription sur la LPP.
Le sujet premier de l’étude a d’abord été l’objectif du PPP, que ses concepteurs ont qualifié de « composante essentielle de l’approche multidimensionnelle adoptée par le Canada en matière de sécurité ». L’étude s’est ensuite attachée au rôle joué par le SCRS dans le processus d’inscription sur la LPP, puis aux processus et politiques internes qui le guident dans ce rôle, les critères que le SCRS applique pour désigner une personne et les « leçons tirées » des cinq premières années d’existence du Programme.
En particulier, le CSARS a examiné si le SCRS avait élaboré des politiques ou des procédures appropriées, notamment des critères clairs et cohérents, pour guider son processus d’inscription.
L’étude a permis de cerner diverses questions de fond qui ont nui au bon fonctionnement du PPP.
Le CSARS a constaté que le seuil fixé dans la loi à l’égard du Programme est difficile à respecter en pratique. Pour les ministères chargés des désignations, cela a suscité des incertitudes quant aux critères d’inscription sur la LPP. En vertu du PPP, une personne inscrite sur la LPP peut se voir refuser l’embarquement si l’on croit qu’elle peut représenter une « menace immédiate » pour la sûreté de l’aviation, seuil qui s’enracine dans la Loi sur l’aéronautique. La notion de « menace immédiate » laisse place à interprétation, de sorte que les ministères et organismes chargés des désignations ont eu du mal avec le processus prévu à cette fin.
Cette imprécision a aussi fait l’objet d’un débat public, les associations de défense des libertés civiles (entre autres) s’en étant prises au fait que la loi ne prévoyait pour le programme aucune limite ni mandat clair, à leur avis. Le CSARS a constaté que ces défis et faiblesses ont considérablement réduit la possibilité que la LPP soit un outil efficace pour la sûreté de l’aviation.
Même si Transports Canada a fourni des documents d’orientation destinés à aider les ministères chargés des désignations, ceux-ci sont demeurés dans l’incertitude quant au sens précis de « menace immédiate ». Le CSARS a constaté que, pour aggraver le problème, le SCRS n’avait pas pris les mesures nécessaires pour arrêter des critères explicites et uniformes destinés à guider son processus d’inscription.
Le CSARS a relevé deux incohérences notables dans l’approche globale du SCRS à l’inscription sur la LPP.
Premièrement, les désignations englobaient un vaste éventail de liens entre les personnes désignées et les menaces particulières à la sûreté du transport aérien. Cela semble s’écarter de la pratique établie qui était de mettre davantage l’accent sur l’établissement d’un lien direct avec la sûreté de l’aviation. Le CSARS s’est dit inquiet de ce manque de cohérence et de l’absence de critères de désignation clairement définis.
Une deuxième zone d’incohérence touchait la question de savoir si les autorités de la LPP devraient utiliser des renseignements secrets, et en quelles circonstances le faire, pour corroborer les désignations du Service. Au début, le Service a opté pour une approche circonspecte en proposant des personnes dont la désignation pouvait recevoir des appuis de l’extérieur, surtout de renseignements de sources ouvertes. Le CSARS a toutefois noté que le SCRS a délaissé cette position initiale, ce qui l’a amené à constater qu’il devrait y avoir des paramètres clairs et explicites pour régler le compromis entre les risques liés à la divulgation de renseignements secrets et la sûreté accrue du transport aérien.
Dans l’ensemble, le CSARS a constaté que les faiblesses du PPP avaient occasionné des incohérences dans l’approche du Service à la désignation.
Bien qu’il soit convaincu que cette approche était généralement prudente, le CSARS a constaté que l’absence de directives internes et de définition claire dans la loi a amené le SCRS à adopter une approche plutôt ponctuelle dans la désignation des personnes à inscrire sur la LPP.
Le CSARS recommande que le SCRS élabore sous peu un ensemble cohérent de critères visant à déterminer les désignations éventuelles, tout en étant conscient que ces critères pourront devoir être modifiés régulièrement au fil du programme.
Étude du CSARS : Le rôle du SCRS dans le processus d’attestation de danger pour la sécurité
Le certificat de sécurité est un instrument administratif qui autorise le gouvernement du Canada à détenir et à expulser les non-Canadiens (c.-à-d. des résidents permanents ou des étrangers) qui sont réputés être des menaces à la sécurité. Le processus de certificat ou d’attestation de danger pour la sécurité, prévu dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), donne lieu à une procédure d’immigration, et non à une procédure pénale. Un certificat peut être délivré pour diverses raisons de sécurité, notamment l’espionnage et le terrorisme, la violation de droits de la personne et du droit international et l’implication dans la criminalité grave ou organisée.
Ces dernières années, le régime des certificats de sécurité a été fort malmené. Dans un important arrêt rendu en 2007 (Charkaoui c. Canada), la Cour suprême du Canada a déclaré ce régime inconstitutionnel parce que la personne nommée dans le certificat ne pouvait connaître les renseignements utilisés dans la genèse de la notion de certificat. Cela a amené une importante réforme prévoyant la nomination d’avocats spéciaux chargés de défendre les intérêts des personnes désignées lors des procédures à huis clos sur les certificats de sécurité. Dans le contexte de ces contestations judiciaires, les conseils fournis par le SCRS aux ministres de la Sécurité publique et de la Citoyenneté et de l’Immigration ont aussi été l’objet d’un examen minutieux.
Étude du CSARS
Cette étude a porté sur les processus et les politiques internes du Service ayant trait à son rôle en matière de certificats de sécurité, qui consiste principalement à préparer un rapport de renseignement de sécurité (RRS), lequel contient ses informations et son évaluation à savoir si une personne représente une menace pour la sécurité nationale.
Le CSARS a examiné en quoi le Service a modifié ses pratiques pour se plier à diverses questions soulevées par les tribunaux dans le contexte des procédures de certificat de sécurité, notamment les défis que comporte l’utilisation accrue de renseignements du SCRS dans les procédures judiciaires.
En particulier, le Comité a examiné la réponse du SCRS à certaines questions soulevées par la Cour fédérale dans quelques affaires de certificat de sécurité. Ce faisant, il a aussi examiné en quoi la Cour fédérale a demandé au Service d’examiner d’un œil critique le rôle qu’il joue dans les certificats de sécurité, à savoir : les renseignements recueillis auprès de sources humaines et la manière de les transmettre aux tribunaux, les lignes directrices relatives aux documents préparés par le Service à l’appui des certificats de sécurité, la préparation des témoins qui comparaissent devant la Cour fédérale, et les pratiques du SCRS concernant la présentation de renseignements dans les procédures judiciaires.
Le CSARS a constaté que le Service a donné suite aux préoccupations de la Cour fédérale de trois façons principales.
Premièrement, le SCRS a élaboré une politique sur la préparation et l’approbation du document important, appelé précis de sources humaines, qu’il utilise pour transmettre à la Cour des renseignements sur ces sources. Le SCRS a admis la gravité de son échec à fournir à un juge, en temps opportun, d’importants renseignements sur des sources humaines dans une affaire de certificat. À cette fin, les gestionnaires du Service ont rapidement entrepris un examen minutieux des procédures entourant la préparation du précis de sources humaines.
Aussi a-t-on consigné les procédures de préparation de ces précis dans une politique obligeant à les soumettre tous à une séance d’examen critique. Cela suppose la participation de conseillers juridiques chargés d’assurer l’exactitude des renseignements contenus dans ces documents. De plus, la politique énonce le type de renseignements que le précis doit contenir et dont la Cour doit disposer pour évaluer de façon indépendante la fiabilité d’une source humaine.
Le CSARS a constaté que le SCRS avait pris des mesures pour cerner la cause de l’erreur susmentionnée et apporté des correctifs pour éviter que la chose se reproduise. Comme les précis de sources humaines servent aussi à appuyer les demandes de mandat, l’application de cette nouvelle politique est vaste.
Deuxièmement, le SCRS a établi des lignes directrices sur la comparution de ses témoins devant les tribunaux dans des affaires de certificat de sécurité. Ainsi, le Comité a appris que les Services juridiques du SCRS ont élaboré un guide de préparation des témoins qui couvre des questions particulières aux certificats de sécurité. Cela est d’autant plus important que les employés du SCRS doivent maintenant témoigner en cour en présence d’avocats spéciaux, ce que le Service a qualifié de « nouvelle réalité » importante.
Le SCRS a aussi créé une nouvelle direction qui réunit les litiges civils et ceux en matière d’immigration de manière à améliorer l’expertise et à favoriser l’uniformité sur différents plans du contentieux du Service.
Troisièmement, le SCRS a créé un vaste programme de formation visant à favoriser la « rigueur » dans ses diverses activités, notamment celles qui ont trait aux tribunaux. Pour renforcer ces efforts, les Services juridiques ont élaboré un « module d’orientation judiciaire » pour les nouveaux agents de renseignement. Ce module couvre un vaste éventail de thèmes et de questions juridiques, dont les renseignements utilisés à titre de preuves, la divulgation, les témoignages et la Charte canadienne des droits et libertés. S’il y a lieu, les Services juridiques donnent aussi une formation juridique aux employés en poste. De plus, des exposés sont donnés au personnel régional du SCRS sur les questions soulevées devant les tribunaux et sur leurs implications pratiques.
Tout en signalant ces changements importants, le CSARS est conscient que l’utilisation des certificats de sécurité comme outil judiciaire suscite de moins en moins d’intérêt – pas seulement au SCRS mais dans toute l’administration publique – en raison des défis qu’ils comportent, notamment dans les affaires de lutte au terrorisme. Pour sa part, le processus d’attestation de danger pour la sécurité impose au SCRS d’importantes obligations de divulgation, laquelle peut être particulièrement problématique du fait que certains renseignements utilisés dans les RRS émanent de services étrangers.
Le CSARS estime que les tribunaux fournissent au Service d’importantes orientations sur la manière dont il doit remplir ses fonctions, ce qui lui permet en revanche de donner suite aux contestations judiciaires. En conséquence, le CSARS recommande que le SCRS entreprenne un examen complet, axé sur l’avenir, des décisions judiciaires pertinentes pour assurer une bonne compréhension de ce qu’elles impliquent pour le Service sur le plan des opérations, des processus et des ressources.
Le Comité croit que le SCRS continuera de prendre part aux autres processus liés à la LIPR, dont certains peuvent obliger à préparer des RRS. Il estime donc que le Service devrait apporter certains changements à leur préparation. À cette fin, le CSARS a fait diverses suggestions précises, notamment en encourageant le Service à faire appel à toutes les sources d’expertise dont il dispose, dans le processus de préparation des RRS, pour assurer que ceux-ci soient conformes aux attentes d’ordre judiciaire, quant au fond.
Le SCRS s’est engagé à trouver des moyens de faire face aux difficultés que comporte la présentation de renseignements à titre de preuves dans le cadre judiciaire canadien. Il a pris des mesures pour satisfaire aux inquiétudes particulières suscitées dans ces affaires, mais le CSARS estime qu’il pourrait gérer de façon plus stratégique son engagement à l’égard des processus judiciaires et qu’il devrait entreprendre un examen plus complet des questions et critiques qui émanent des décisions judiciaires afin d’en évaluer l’impact global sur les processus et les pratiques du Service.
Étude du CSARS : Le rôle du SCRS dans une enquête sur la lutte contre la prolifération
Cette étude a amené à examiner l’enquête menée par le SCRS sur une importante menace de prolifération, celui-ci ayant mis l’accent sur la collecte et l’analyse de renseignements relatifs à cette menace. Elle a aussi porté sur les conseils fournis au gouvernement du Canada relativement à cette affaire. En raison de la portée internationale de cette enquête, le CSARS s’est attaché à la coopération du SCRS avec ses partenaires du renseignement étranger, ce qui lui a donné un aperçu de la planification et de l’exécution d’opérations du Service hors du pays. Cela lui a aussi permis de comprendre la gestion des sources humaines, les avantages opérationnels que le SCRS tire de ces activités et ce en quoi le Service a adapté ses stratégies de gestion du risque pour faire face à des cadres d’activité de plus en plus périlleux.
Étude du CSARS
Dans l’affaire examinée, le SCRS a adopté une stratégie d’enquête comportant de nombreux aspects pour répondre à des objectifs à court et à long terme face à une menace particulière de prolifération. À court terme, le SCRS a mis l’accent sur l’intensification des efforts de collecte auprès de toutes les sources humaines existantes et possibles. Néanmoins, le recrutement d’un grand nombre de sources facilement accessibles n’est qu’un premier pas; il est tout aussi important de pouvoir exploiter l’information recueillie et en tirer parti.
Ainsi, la stratégie à long terme du SCRS consiste à améliorer sa capacité opérationnelle à l’étranger et son expertise à l’égard de la menace en question. La réaction favorable des clients du Service face à ses produits du renseignement relatifs à cette menace donne à penser que ces stratégies aident le SCRS à répondre aux exigences du gouvernement du Canada en matière de renseignement.
Au fil de cette étude, le CSARS a eu vent d’un échec opérationnel sérieux qui a mis en relief les risques inhérents aux activités opérationnelles à l’étranger. À la suite de rencontres avec les responsables du SCRS et d’un examen minutieux de la documentation, le CSARS a conclu qu’aucune action particulière du SCRS n’avait mené à l’échec final de cette opération même, à l’étranger. Il s’agit plutôt du concours de divers facteurs dont bon nombre échappaient au contrôle du SCRS.
Vu l’importance de la gestion du risque dans la planification et l’exécution d’opérations à l’étranger, le CSARS a choisi d’examiner de plus près les mesures que le SCRS a prises pour améliorer ce processus. Celles-ci englobent la manière de cerner les risques, les consultations internes qui sont tenues, les mesures de contrôle ou d’atténuation prises pour aider à gérer les risques et le rôle que joue la direction dans l’approbation de ces efforts.
Le CSARS avait déjà exprimé des préoccupations au sujet des stratégies de gestion des risques opérationnels (GRO) du SCRS. Ainsi, il a mené en 2008 deux études ayant eu pour conclusion que le SCRS manquait de critères pour effectuer des évaluations de risques. Aussi le CSARS avait-il recommandé au SCRS d’améliorer ses définitions du risque et de normaliser ses évaluations par une terminologie détaillée et uniforme. À l’époque, le CSARS avait aussi demandé au SCRS s’il ne devrait pas être plus transparent dans ses rapports opérationnels pour aider à expliquer le processus décisionnel entourant sa gestion du risque.
Peu après, le SCRS a lancé un processus de GRO tout à fait nouveau, conçu pour aider à satisfaire aux exigences en matière de renseignements par l’évaluation et l’atténuation des risques à un degré jugé acceptable pour l’organisation. Le Service soutient que ce nouveau processus donne des évaluations de risque qui sont systématiques, qui montrent une prise de décisions transparente, qui englobent toutes les opinions pertinentes des intervenants et qui sont dictées par le bon sens.
Pour jauger dans quelle mesure le nouveau processus de GRO du SCRS est conforme à ces principes, le CSARS a examiné les évaluations de risques de toutes les opérations mixtes visées par cette enquête. Il a constaté que, même si l’on ne peut jamais éliminer complètement les risques opérationnels, le SCRS a réussi à créer une approche plus systématique et méthodique à la gestion des risques en modifiant à la fois sa politique et ses processus. Voici quelques-unes des améliorations les plus importantes : définitions claires et concises du risque, formation des employés spécialisés, identification des intervenants et des responsabilités de chacun, politique indiquant le niveau de gestion dont doivent émaner les approbations pour chaque degré de risque, grilles d’évaluation du risque exigeant des intrants mesurables, et désignation d’un centre de responsabilité pour intégrer les leçons tirées d’opérations antérieures.
L’étude du CSARS l’a aussi amené à constater, toutefois, une absence notable de détails sur les organismes partenaires en dépit du fait que les évaluations de risques étaient conçues de manière à tenir compte des facteurs opérationnels. Le CSARS recommande donc qu’à l’avenir, les évaluations de risques devraient comporter une appréciation plus nuancée et complète des organismes partenaires pris isolément, s’il y a lieu.
Avec le temps, cette information contribuera à une appréciation plus transparente et stratégique des avantages uniques et des défis que peut comporter la mobilisation des partenaires au cas par cas.
Le CSARS note avec satisfaction qu’à la suite de cette étude le SCRS l’a informé que le processus de GRO comprend maintenant plus d’informations sur les capacités et les intentions des organismes partenaires étrangers.
Cette étude a mis en relief les progrès constants du SCRS à se hisser au rang des acteurs importants sur la scène opérationnelle étrangère afin d’obtenir des renseignements sur une menace grave de prolifération. La mise en œuvre de cette stratégie a amené le Service à adopter de nouvelles politiques, pratiques et procédures à l’égard de ses activités à l’étranger. Le SCRS a également accru son niveau de connectivité avec les alliés, aggravant aussi du même coup les risques d’ordre opérationnel.
Le CSARS continuera de suivre les activités du SCRS à l’étranger pour s’assurer que celui-ci a ce qu’il faut pour fournir les conseils et le soutien requis au gouvernement du Canada, tout en gérant les risques que cela comporte.
Étude du CSARS : La radicalisation d’origine intérieure
Par les années passées, peu de menaces à la sécurité nationale ont suscité des préoccupations aussi vives que le phénomène de radicalisation relatif au terrorisme islamique sunnite. Le terme « radicalisation » vise généralement le processus qui amène à légitimer le recours à la violence pour atteindre des objectifs à caractère politique. Le gouvernement du Canada a pour priorité de trouver des moyens de stopper ou d’entraver ce processus de manière à réduire le risque de terrorisme au Canada et d’implication de Canadiens dans des activités terroristes à l’étranger.
Cela exige une approche pangouvernementale, que pilote Sécurité publique Canada.
Le SCRS a un rôle important à jouer dans les vastes initiatives gouvernementales qui ont trait à la radicalisation. Dans son dernier rapport annuel public, il a mentionné que la menace que représentent l’endoctrinement et la radicalisation des jeunes Canadiens à qui est inculquée l’idéologie violente préconisée et inspirée par al-Qaïda, et couramment appelée « extrémisme islamique d’origine intérieure », demeure une préoccupation de premier plan. Le SCRS s’est employé à comprendre la menace que représente le phénomène de la radicalisation au Canada, à identifier les personnes et les groupes radicalisés et à déceler les moyens employés pour les radicaliser.
Le travail d’enquête et d’analyse du SCRS gravite autour de la menace une fois que le processus de radicalisation est complet, soit la possibilité de violence et la menace qu’elle représente pour la sécurité nationale.
Étude du CSARS
L’objectif de cette étude était d’examiner la manière dont le SCRS comprenait la menace de radicalisation au Canada, ainsi que son enquête et son analyse de ce phénomène. Elle a porté sur ce qu’est la radicalisation d’origine intérieure dans le contexte canadien et sur la manière dont elle a évolué et dont le SCRS s’y est pris pour recueillir des renseignements sur cette menace. Le CSARS a aussi examiné la manière dont le Service analyse le phénomène de la radicalisation d’origine intérieure de façon à mieux comprendre ce processus et à conseiller le gouvernement.
Dans son étude, le CSARS a pu observer que la radicalisation d’origine intérieure n’est pas un problème isolé, mais qu’elle fait partie de la menace qui afflige de plus en plus le monde depuis une décennie. Au début, la menace première venait de non-Canadiens qui, de l’étranger, cherchaient à s’en prendre à des Canadiens au pays même ou à l’extérieur. Par la suite, il s’est agi de Canadiens qui adhèrent à des organisations terroristes étrangères et attaquent d’autres pays, le Canada ou des Canadiens, ainsi que de personnes qui sont radicalisées au Canada puis se livrent à la violence ici même ou à l’étranger.
Dans l’ensemble, le CSARS a constaté que l’enquête du SCRS sur la radicalisation et l’analyse qu’il en fait ont évolué de manière à refléter ses connaissances sur ce problème et à lui permettre d’exploiter plus efficacement les ressources dont il dispose.
Le CSARS a toutefois fait état de trois défis que le SCRS doit relever dans son enquête sur la radicalisation d’origine intérieure : faire face à l’utilisation croissante de l’internet comme moyen de radicalisation, recueillir et échanger des informations sur des cibles et des personnes âgées de moins de 18 ans, et établir l’ordre de priorité de menaces de plus en plus nombreuses.
Le rôle de l’internet
Le processus de la radicalisation au Canada est en grande partie mené par des leaders charismatiques, des groupes d’amis et des membres de familles, mais beaucoup ont affirmé que l’internet a « changé la donne », entre autre parce qu’il a permis à l’idéologie extrémiste d’atteindre rapidement un auditoire international. De nos jours, les gens peuvent être radicalisés dans le cadre presque unique de collectivités virtuelles, sans avoir beaucoup de rapports directs avec autrui.
Il ne faut donc pas se surprendre que le volume sans cesse croissant d’activités virtuelles liées à une menace ait été pour le SCRS un important défi en matière d’enquête. La surveillance de ces activités exige beaucoup de ressources et le Service est conscient que bien des gens qui semblent avoir été radicalisés sur le Web ne représentent pas une menace réelle. Pour le SCRS, cibler un individu en raison d’activités virtuelles requiert des motifs raisonnables de le soupçonner d’être impliqué dans des activités liées à une menace.
Néanmoins, s’il y a peu d’interaction avec le monde réel, il peut être difficile d’enquêter sur ces activités par des méthodes traditionnelles, telle la filature. En conséquence, le SCRS peut décider de demander un mandat plus tôt dans le processus d’enquête pour se voir octroyer des pouvoirs et des outils plus intrusifs afin de pousser son enquête plus loin. Même en pareil cas, si le Service veut se voir conférer des pouvoirs par voie de mandat, il doit démontrer de façon convaincante que ces pouvoirs intrusifs feront progresser son enquête et que les autres méthodes d’enquête ont peu de chances de réussir.
Le SCRS a donc élaboré des outils propres à aider les enquêteurs à déterminer s’il y a lieu de cibler un individu et s’il est justifié de demander un mandat contre lui en se fondant sur ses activités virtuelles. Le CSARS appuie les efforts du SCRS à épuiser les méthodes d’enquête moins intrusives avant de demander un mandat selon l’article 21 à l’égard d’enquêtes dont un élément virtuel est essentiel.
Mandats
Le pouvoir d’autoriser des techniques d’enquête intrusives appartient exclusivement à la Cour fédérale du Canada. En décernant un mandat au SCRS, la Cour l’autorise à recourir à des techniques d’enquête qui seraient illégales autrement, par exemple la surveillance de télécommunications. Le tableau qui suit montre le nombre de mandats que la Cour fédérale a décernés au cours des trois derniers exercices financiers.
| 2009–2010 | 2010–2011 | 2011–2012 | |
|---|---|---|---|
| Total | 229 | 231 | 206 |
| Nouveaux mandats | 36 | 55 | 50 |
| Mandats remplacés ou renouvelés | 193 | 176 | 156 |
Intensification de l’interaction avec les jeunes
Second défi relevé par le CSARS : comme les jeunes sont souvent la cible d’efforts de radicalisation, le SCRS risque beaucoup de voir de plus en plus de mineurs être des sources d’inquiétudes ou des cibles. Traiter avec des mineurs représente un défi pour le Service, tant dans sa façon d’enquêter que dans ses pratiques de collecte, de conservation et de divulgation d’informations.
Le CSARS a constaté que le SCRS a agi avec réserve et sensibilité dans ses interactions avec les mineurs, mais il estime qu’un même niveau de considération devrait être porté à l’échange d’informations et aux rapports opérationnels.
La politique opérationnelle ne prévoit pas de processus d’approbation clair quant à l’échange d’informations au sujet de mineurs, notamment avec des partenaires étrangers. Le CSARS estime qu’en ce qui concerne l’échange d’informations sur les mineurs, le SCRS devrait élaborer une politique définissant clairement les responsabilités et les mécanismes d’approbation.
Le CSARS recommande que le SCRS élabore une nouvelle politique concernant l’échange d’informations sur des mineurs avec des partenaires étrangers ou qu’il modifie la politique existante sur l’échange d’informations de manière qu’elle reflète une sensibilité appropriée à l’égard des jeunes.
Une autre question touchant les informations sur les mineurs concerne la collecte et la conservation de celles-ci dans les rapports opérationnels du Service. Actuellement, le SCRS n’est pas tenu d’indiquer clairement dans ces rapports que les renseignements contenus dans un message donné ont trait à un mineur.
Pour assurer qu’une attention et une sensibilité appropriées soient portées aux renseignements recueillis et conservés sur des mineurs, le CSARS recommande que tous les rapports opérationnels contenant de tels renseignements portent une mention à cet effet.
Ordre de priorité à donner aux menaces
Un troisième type de défi qui s’est posé au SCRS ces dernières années a été l’obligation de gérer judicieusement ses ressources, en raison notamment du nombre sans cesse croissant des menaces. À cette fin, le SCRS a élaboré des outils destinés à l’aider à établir l’ordre de priorité de ses enquêtes et des ressources qu’il y affecte.
Les enquêtes du SCRS sont demeurées axées sur la radicalisation à titre de volet en croissance de la menace, phénomène qui ajoute une nouvelle dimension à son travail de sensibilisation, à son analyse et aux conseils destinés au gouvernement. En fait, bien que le terrorisme constitue nettement une menace selon l’article 12 de la Loi sur le SCRS, ce n’est pas le cas de la radicalisation à titre de processus. Le SCRS peut légitimement recueillir des renseignements sur la menace que représentent les personnes radicalisées, mais les autres informations, telles les « causes profondes », peuvent déborder son mandat.
Le SCRS est conscient de l’existence de limites aux informations et aux conseils qu’il peut fournir au gouvernement sur cette question, en raison surtout de « la nature de son mandat qui oblige le Service à enquêter sur les menaces à la sécurité nationale (et donc sur les personnes qui montrent déjà des signes de radicalisation violente) ».
Le CSARS n’en craint pas moins que, vu que le SCRS veut élargir ses connaissances, des facteurs à la fois intérieurs et extérieurs puissent le pousser à recueillir des renseignements qui n’entrent pas nettement dans les limites de l’article 12. À cet égard, le CSARS encourage le SCRS à conserver son concept actuel de la radicalisation à titre d’élément du tableau complexe de la menace, et non de moteur d’enquêtes en tant que tel.
Étude du CSARS : L’appui du SCRS à l’égard des dossiers nouveaux et des priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement
Le SCRS axe ses efforts de collecte de renseignements sur les priorités du gouvernement du Canada à cet égard. Ces dernières années, face au contexte d’une menace aggravée et changeante, ces priorités ont englobé de nouvelles exigences en matière de renseignement de sécurité qui ont amené le SCRS à étendre ses activités d’ordre opérationnel dans des domaines inhabituels tels que l’aide au gouvernement dans les dossiers d’enlèvement à l’étranger et d’immigration clandestine.
Le gouvernement a demandé au SCRS de lui fournir des renseignements sur les enlèvements de Canadiens à l’étranger lorsque ces faits sont reliés à des groupes extrémistes. En conséquence, le Service a ouvert un nouveau créneau opérationnel. La migration illicite et le passage clandestin d’immigrants sont un autre domaine d’importance croissante. Divers groupes terroristes font appel à des réseaux d’immigration clandestine pour appuyer leurs objectifs. Dans le cadre de ses enquêtes sur ces groupes et leurs activités, qui peuvent représenter une menace pour les intérêts canadiens, le SCRS s’emploie avec des partenaires canadiens à stopper le passage clandestin d’immigrants qui fait appel à des navires à destination du Canada.
La réponse à ces deux menaces nouvelles a pour point commun que le SCRS est tenu de collaborer étroitement avec les autres ministères et organismes fédéraux suivant une approche « pangouvernementale ».
Étude du CSARS
Cette étude a amené à examiner l’impact des affaires d’enlèvement et d’immigration clandestine sur les opérations « traditionnelles » du Service et à évaluer si les ressources et la formation dont celui-ci dispose sont suffisantes. De façon plus générale, le CSARS a exploré l’apport du SCRS aux approches pangouvernementales à l’égard des nouvelles questions liées au renseignement de sécurité en examinant sa coopération et ses échanges avec ses partenaires canadiens et ses alliés étrangers.
L’intérêt du SCRS pour les enlèvements de nature politique par des groupes ou des personnes représentant une menace pour la sécurité nationale au Canada n’est pas nouveau. Ce qui l’est, cependant, c’est la nature et l’ampleur de sa participation opérationnelle. On peut en dire autant de la part jouée par le SCRS dans les dossiers d’immigration clandestine. Dans l’ensemble, le CSARS a constaté que la collecte de renseignements et les conseils donnés au gouvernement sur ces questions par le SCRS – au moyen de ses enquêtes sur les menaces à la sécurité nationale du pays – étaient précieux et avisés. En particulier, le CSARS a constaté que la liaison et les échanges du SCRS avec ses partenaires étrangers se sont révélés inestimables pour les décideurs du gouvernement.
L’approche du gouvernement du Canada face aux prises d’otages varie selon la nature de chaque affaire. Si un enlèvement à l’étranger est considéré comme une menace à la sécurité nationale, on forme un groupe de travail interministériel réunissant tous les ministères et organismes compétents, dont le principal objectif est d’assurer que les otages soient libérés sains et saufs. Au sein de ce groupe, le rôle du SCRS reflète son mandat : recueillir et fournir des renseignements sur les menaces à la sécurité nationale – l’objectif ultime dans l’affaire étant de faciliter la libération des otages. Ce travail est exécuté par des unités ou équipes de gestion de crise qui sont formées pour prendre en charge des dossiers particuliers d’enlèvement.
Dans l’ensemble, le SCRS contribue à l’approche pangouvernementale aux dossiers d’enlèvement par deux moyens principaux.
Premièrement, à l’aide des moyens d’enquête dont il dispose, le SCRS recueille des renseignements sur le groupe ou les individus extrémistes à l’origine d’un enlèvement et il en fait part au gouvernement. Le renseignement humain que le SCRS peut recueillir à l’étranger dans le cadre de cet effort de collecte est particulièrement précieux, fournissant un aperçu unique, en dépit des difficultés qui sont associées aux opérations à l’étranger.
Deuxièmement, et ce moyen est peut-être plus important, le SCRS peut demander l’aide de ses partenaires étrangers qui s’emploient dans le monde entier à recueillir de précieux renseignements. Au fil des ans, le SCRS a noué et entretenu des relations avec nombre de services de renseignement étrangers dont beaucoup sont présents dans des pays où le SCRS ne l’est pas et dont certains échangent des informations uniquement avec des homologues du renseignement (c.-à-d. autres que des responsables du maintien de l’ordre ou des Affaires étrangères). La liaison a permis au SCRS de puiser à ces ressources pour obtenir des informations qu’il ne pourrait se procurer par lui-même.
Pour être en mesure de faire face aux affaires d’enlèvement à l’étranger sans compromettre sa capacité de s’acquitter de ses autres responsabilités, voici trois défis de taille que le SCRS doit relever, selon le CSARS : le problème du manque de ressources, l’établissement de processus et procédures internes appropriés, et l’impact de l’intensification des activités de collecte à l’étranger.
La direction du SCRS a déjà pris acte des deux premiers défis. Le CSARS a été informé que le Service continue de fonder sur la gestion du risque son approche au traitement des enlèvements. Cela lui donne plus de souplesse du point de vue des opérations et des ressources.
Bien que chaque affaire d’enlèvement soit unique, le CSARS se demande s’il est souhaitable de continuer de se fonder sur une approche ponctuelle. Même si le SCRS a relevé certains défis logistiques, peu d’éléments attestent qu’il a pris des mesures plus générales pour élaborer des procédures opérationnelles courantes et des stratégies en vue de faire face à de telles crises.
Le CSARS estime que l’approche du Service aux affaires d’enlèvement devrait être l’objet d’une planification stratégique plus vaste. Pour rendre plus efficace et plus durable la part jouée par le SCRS dans ces affaires, le CSARS lui recommande d’élaborer des procédures opérationnelles appropriées et des mécanismes visant à améliorer sa capacité opérationnelle et son expertise.
De plus, l’étude du CSARS a confirmé que la liaison avec des partenaires étrangers permettait d’optimiser les ressources. Même s’il peut être approprié que, devant une situation de crise à court terme, le SCRS intensifie sa présence et ses activités d’ordre opérationnel pour contrer une menace à la sécurité nationale du pays, le CSARS se demande s’il est possible de continuer de le faire sans ressources supplémentaires, dans les parties du monde aux prises avec des troubles.
Pour ce motif, alors que le SCRS continue de faire face aux nouvelles questions dans un cadre pangouvernemental, une vision et une planification plus stratégiques s’imposeront.
Le Service a œuvré dans les dossiers d’immigration clandestine par son rôle de filtrage de sécurité en vertu des articles 14 et 15 de la Loi sur le SCRS. Ces dernières années, toutefois, le passage clandestin d’immigrants étant devenu une priorité du gouvernement en matière de sécurité, le SCRS a tenté d’accroître sa capacité opérationnelle sur ce plan. Ce n’est pas le SCRS qui pilote ces dossiers : son rôle se limite à fournir de l’information et des conseils ayant trait aux menaces à la sécurité nationale. Le principal objectif est de recueillir des renseignements que des partenaires canadiens et étrangers pourraient exploiter pour influencer ou perturber « sur place » les activités d’immigration clandestine.
Ces dernières années, le SCRS a lancé plusieurs initiatives stratégiques visant à soutenir sa capacité opérationnelle à faire face à ces nouvelles menaces. Il a aussi créé une unité spécialisée à titre de centre de responsabilité pour toutes les affaires ayant trait à l’immigration clandestine, tout en fournissant des pistes de renseignement au personnel compétent du SCRS au Canada et à l’étranger. L’unité cherche à créer une expertise interne et à servir de voie d’échange d’informations avec les partenaires canadiens compétents. Dans les affaires examinées, le CSARS a constaté que les informations recueillies par le SCRS dans le cadre de ses enquêtes au Canada sont essentielles à son rôle dans les dossiers d’immigration clandestine.
Le gouvernement ayant fait du passage clandestin d’immigrants une priorité en matière de sécurité, le CSARS s’attend à ce que le SCRS accroisse sa participation opérationnelle dans les dossiers d’immigration clandestine. Pour éviter de grever ses autres activités opérationnelles traditionnelles, tant au Canada qu’à l’étranger, le SCRS devra traiter l’immigration clandestine en priorité.
Dans l’ensemble, le CSARS a constaté que la participation du SCRS à ces opérations pangouvernementales lui avait procuré certains avantages d’ordre opérationnel qui favorisent des exigences élargies en matière de renseignement.
Néanmoins, étant donné que le SCRS s’emploie à satisfaire à ces exigences en matière de renseignement, il devra réfléchir à ses stratégies (à la fois au Canada et à l’étranger) afin de répondre à cette demande. L’accès unique du SCRS à la collectivité internationale du renseignement est un élément clé de son apport et, en fait, le CSARS a constaté que la liaison et les échanges du SCRS avec les partenaires étrangers se sont révélés son meilleur atout dans les dossiers d’enlèvement et d’immigration clandestine.
Pour satisfaire aux nouvelles exigences du gouvernement en matière de renseignement, il faudra peut-être réaliser un meilleur équilibre entre optimiser les occasions de liaison existantes et élargir l’empreinte opérationnelle du Service à l’étranger. Le CSARS estime que le SCRS devra amorcer une réflexion plus stratégique et une planification à long terme afin de s’assurer d’être bien placé, et de le demeurer, pour établir un tel équilibre et, en conséquence, satisfaire à ces exigences avec les ressources dont il dispose.
Étude du CSARS : Un poste du SCRS à l’étranger
Ces dernières années, le contexte mondial de la menace a amené le SCRS à élargir la nature et la portée de ses activités à l’étranger pour répondre aux besoins accrus du gouvernement en matière de collecte de renseignements hors du pays. Pendant cette période, le SCRS a conclu nombre de nouvelles ententes avec des organismes étrangers et plusieurs agents affectés hors du pays ont été habilités à recueillir activement des renseignements pour appuyer les opérations du SCRS.
Les toutes dernières études de postes effectuées par le CSARS concernaient des bureaux plus occupés. Cette année, le CSARS a choisi d’examiner un poste plus modeste du SCRS. Cette étude l’a amené à scruter les ententes et les échanges avec des organismes étrangers, à ce poste, les responsabilités des agents de collecte à l’étranger (ACE) du SCRS, le soutien de celui-ci aux autres ministères et organismes fédéraux à ce poste, ainsi que les faits nouveaux, conditions, pressions et nouvelles questions qui y sont particuliers.
Étude du CSARS
Le CSARS a pris note des efforts intenses déployés ces dernières années par les ACE pour rendre ce poste plus opérationnel. La situation géographique stratégique du pays hôte semble idéale pour les activités opérationnelles. Cependant, la chose s’est avérée extrêmement difficile, en raison notamment des activités de contre-espionnage du pays hôte.
Le personnel du poste avait des rapports de liaison et des échanges d’information limités avec l’organisme intérieur en dépit des efforts du Service à l’engager dans des dossiers d’intérêt commun. Dans le contexte de ces échanges, le CSARS a constaté que le SCRS exerçait une diligence raisonnable lorsqu’il envisageait d’échanger des informations concernant ses propres cibles, notamment lorsqu’elles passaient par le pays hôte ou s’y rendaient, à cause de préoccupations touchant les violations de droits de la personne. Le CSARS a aussi noté que les renseignements échangés avec l’organisme intérieur au cours de la période à l’étude comportaient les mises en garde voulues.
Les ACE se sont en outre efforcés de cultiver leurs contacts officieux avec les autres partenaires étrangers affectés dans le pays. Le CSARS a noté que, par le passé, les informations obtenues de ces partenaires étaient au moins aussi précieuses que celles reçues du pays hôte. En particulier, il a constaté l’amorce d’un important travail de liaison avec ces contacts relativement à une enquête prioritaire du SCRS.
Dans l’ensemble, le CSARS a constaté que les relations entre le SCRS et ses partenaires canadiens à ce poste étaient bonnes. Même si tant le chef de mission que l’ACE titularisé étaient relativement nouveaux, ils semblaient tous deux animés d’un esprit de coopération et au fait du mandat respectif de chaque organisme. Selon les séances d’information tenues lors du passage des représentants du CSARS sur place, les relations du SCRS avec les partenaires canadiens à ce poste sont bonnes, chacun d’eux connaissant bien le mandat et le rôle du SCRS.
Au fil de son examen, le CSARS a relevé deux cas distincts de consignation inappropriée d’informations dans des rapports opérationnels. Ces deux cas ont semé la confusion quant à savoir quelles informations un ACE avait échangées avec un partenaire étranger.
Le CSARS recommande que le SCRS adopte une pratique obligeant les agents de collecte à l’étranger à alerter les modules opérationnels lorsqu’une demande d’échange d’informations avec un partenaire étranger demeure sans suite, pour quelque motif que ce soit, de sorte que le rapport opérationnel puisse être modifié.
L’importance de la liaison est un point saillant de cette étude. Les ACE mettent maintenant l’accent sur la collecte, mais le travail de liaison traditionnel demeure un volet précieux des tâches rattachées à ce poste. De façon plus générale, cette étude a mis en relief la nécessité d’assurer une communication nourrie et efficace entre l’Administration centrale du SCRS et son personnel en poste à l’étranger, notamment dans la marche des opérations requérant une coordination entre différentes personnes. Au moment où le Service accroît sa présence hors du pays, une communication efficace avec les ACE et des rapports opérationnels exacts sur les échanges d’informations sont essentiels, notamment lorsqu’il traite avec des organismes susceptibles d’avoir des pratiques douteuses en matière de respect des droits de la personne.
Étude du CSARS : Les relations du SCRS avec un partenaire étranger
Les réalités modernes du renseignement exigent une coopération poussée avec les partenaires étrangers. En dépit des nombreuses facettes de cette coopération, l’échange d’informations est ce qui a le plus retenu l’attention du public ces dernières années. Cette année, le CSARS a examiné la coopération du Service avec un partenaire étranger particulier dans le cadre de ses activités d’échange d’informations.
Étude du CSARS
Le CSARS a examiné l’évolution des relations du SCRS avec ce partenaire ces dernières années. Il s’est aussi penché sur la manière dont ces faits nouveaux peuvent susciter des défis particuliers, par exemple les inquiétudes concernant les droits de la personne, en matière d’échange d’informations.
Le CSARS a ensuite examiné les stratégies et procédures que le SCRS met en œuvre pour gérer ses échanges d’informations avec ce partenaire, dont la demande à celui-ci de garanties (ou « assurances ») de respect des droits de la personne, l’adoption de nouvelles politiques pour gérer l’échange d’informations et l’usage accru de mises en garde lors de la transmission des informations.
Dans l’ensemble, le CSARS a constaté qu’il y avait eu une importante discussion sur les défis de l’échange d’informations et sur les mesures nécessaires pour gérer ces échanges comme il se doit. Cependant, le CSARS a constaté un manque de clarté et d’orientation dans l’application de ces mesures. Dans la plupart des cas, la mise en œuvre d’une politique claire et structurée est attendue depuis longtemps. Aussi le CSARS a-t-il formulé des recommandations pour guider l’achèvement de lignes directrices appropriées et claires reflétant à la fois les orientations stratégiques actuelles en matière d’échange d’informations et les recommandations de commissions d’enquête indépendantes.
L’étude du CSARS a révélé que le SCRS a consacré beaucoup de temps et d’énergie, notamment aux échelons supérieurs de la direction, à faire part aux partenaires étrangers de ses attentes en matière d’échange d’informations, surtout si elles ont trait aux droits de la personne.
En dépit de ces faits nouveaux positifs, le CSARS a constaté divers domaines où la politique du SCRS ne respectait pas la norme espérée par le Comité. En particulier, il a fait état de préoccupations à l’égard des procédures employées par le SCRS pour atténuer les dangers de l’échange d’informations, et plus précisément : l’obtention systématique d’assurances de partenaires étrangers lorsque ceux-ci lui transmettent des informations, l’ajout de mises en garde aux informations fournies par le SCRS à un partenaire étranger et la délicate question de l’échange d’informations au sujet de jeunes contrevenants.
Premièrement, on ne comprend toujours pas clairement ce que sont réellement les « assurances », le moment où il faut en fournir et la manière dont elles doivent être consignées. Étant donné ce qui semble être un manque de clarté et l’absence de lignes directrices concernant les assurances à obtenir de partenaires étrangers lorsque l’échange d’informations présente un risque important de torture, le CSARS recommande que le SCRS élabore une politique et des orientations sur l’application pratique des assurances, indiquant par exemple le moment et la manière de les demander, sous quelle autorité le faire et le mode de consignation de ce processus dans les rapports opérationnels.
Deuxièmement, l’étude du CSARS a révélé que, même si l’on utilisait des mises en garde particulières pour atténuer les dangers d’échanger des informations de nature délicate avec des entités non canadiennes depuis 2003, leur application n’était pas uniforme : plus d’une dizaine de mises en garde différentes ont été utilisées ces dernières années.
Le CSARS estime que l’une des raisons de l’application non uniforme des mises en garde est que la politique du SCRS sur leur utilisation remonte à 2005 et n’a pas été mise à jour afin de refléter les pratiques plus récentes et les recommandations sur l’échange d’informations avec des partenaires étrangers. Le CSARS est d’avis que la politique sur les mises en garde aurait dû être revue depuis longtemps et, à cet égard, il recommande qu’une mise à jour de la politique soit effectuée de manière à refléter les pratiques et processus actuels d’échange d’informations avec les partenaires étrangers, et qu’elle soit achevée sans plus de retard.
Troisièmement, au fil de son étude, le CSARS a porté une attention spéciale aux pratiques entourant l’échange d’informations au sujet des jeunes. Il a été informé qu’en ce qui touche l’échange d’informations sur les mineurs et les jeunes contrevenants avec des partenaires étrangers, les décisions sont prises au cas par cas. Selon les observations du CSARS, cependant, il semble régner une certaine incertitude au sujet de l’échange d’informations à l’égard de ces personnes.
Étant donné ce qui semble être un manque de clarté quant aux types d’informations qui peuvent ou devraient être échangées au sujet des jeunes contrevenants, le CSARS a encouragé le SCRS à demander un avis juridique pour faciliter l’élaboration de paramètres pour les cas où il traite avec des partenaires étrangers.
En résumé, le CSARS est conscient que l’échange de renseignements entre pays s’impose nettement pour assurer vraiment la sécurité nationale, en particulier à une époque où le terrorisme et les réseaux terroristes hantent le monde. Cependant, pour des organismes comme le SCRS, améliorer l’échange d’informations présente divers défis dont le moindre n’est pas l’obligation de concilier les valeurs démocratiques canadiennes avec les pratiques internationales en matière de renseignement.
Le SCRS s’est employé à élaborer un cadre d’échange d’informations en mettant l’accent sur les partenaires étrangers qui suscitent des inquiétudes à l’égard des droits de la personne. Le CSARS encourage le Service à mettre la dernière main à ce cadre dans les meilleurs délais.
Étude du CSARS : Élaboration et diffusion de produits du renseignement par le SCRS
En plus de recueillir des renseignements sur les menaces à la sécurité du Canada, le SCRS élabore des produits du renseignement et les achemine à divers partenaires du gouvernement du Canada et à des alliés étrangers. Ces dernières années, le SCRS a tenté de soutenir cette fonction en confiant un rôle plus important à la Direction de l’évaluation du renseignement (DER), son organe d’analyse et de diffusion. Ce changement a amené à implanter de nouvelles méthodes d’examen, de traitement, d’analyse et de diffusion des demandes de renseignement, faisant de la DER la plaque tournante du processus du renseignement du SCRS.
Étude du CSARS
Cette étude a porté sur les efforts déployés par la DER pour œuvrer de façon plus étroite aux opérations du SCRS et intégrer aux efforts de collecte du SCRS les priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement.
Le CSARS a examiné en particulier en quoi le SCRS a modifié ses mécanismes destinés à recevoir les réactions des ministères fédéraux, les diverses initiatives entreprises par la DER pour améliorer ses évaluations de renseignements, la demande des différents produits du renseignement du SCRS et ce qui la génère, ainsi que les éléments de la formation offerte aux analystes.
Pour exercer son nouveau rôle central, la DER a subi des changements structurels et organisationnels. Trois types différents d’analystes exercent la plupart de ses responsabilités principales : les analystes stratégiques, les agents aux exigences et les analystes tactiques. Ces postes étaient conçus pour aider la DER à atteindre ses objectifs, à savoir concourir aux opérations et atteindre les clients de l’extérieur qui sont de compétence fédérale. La nouvelle structure a aussi aidé à améliorer l’analyse et la production de renseignements et à y porter une attention accrue. Cependant, chaque type suscite encore divers défis dont le Service reconnaît l’existence.
Parallèlement à sa nouvelle structure, la DER a créé le document contenant les Exigences en matière de renseignements (EMR), qui vise à guider à la fois la collecte et la production. Ce document sert de cadre pour l’agencement des priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement, des directives ministérielles, des ententes en vertu de l’article 16 et des opinions des clients.
La DER élabore aussi la grande majorité des produits du renseignement classifiés du SCRS et les distribue ensuite aux partenaires canadiens et étrangers, comme elle le juge approprié. Au nombre de ces produits figurent :
- les évaluations du renseignement – produit phare du SCRS par lequel celui-ci procure au gouvernement de vastes analyses stratégiques;
- les rapports de renseignement du SCRS (RRS) – rapports de renseignement non évalués;
- les évaluations des menaces et des risques (EMR) – produites pour les ministères fédéraux qui demandent d’évaluer les menaces contre un bien particulier, pouvant peser sur la sécurité nationale.
La DER est aussi chargée de diffuser les rapports de services étrangers (RSE), qui sont des évaluations du renseignement et des produits de gouvernements alliés et autres. D’après les opinions sollicitées de plusieurs clients du SCRS, le CSARS a constaté que les produits du Service concernant les questions de sécurité nationale et le « tableau de la menace intérieure » étaient appréciés, en fait.
De nouveaux protocoles de tenue de dossiers ont aussi été établis pour suivre la production des RRS et, ce qui est plus important, les exigences auxquelles ils satisfont en matière de renseignement. Cependant, les mécanismes de suivi des pouvoirs d’enquête, selon la Loi sur le SCRS, ne font pas la distinction entre les différents types de pouvoirs auxquels fait appel la création du produit. Le CSARS recommande que le SCRS établisse un moyen plus précis pour suivre ses activités de production afin de représenter de façon exacte la proportion des informations au titre de l’article 12 et de celles relevant de l’article 16.
Ciblage
Lorsque le Service a des motifs raisonnables de soupçonner un individu ou une organisation de représenter une menace pour le Canada, il doit d’abord ouvrir une enquête. La figure qui suit indique le nombre de cibles (arrondi à la dizaine la plus proche) sur lesquelles le SCRS a fait enquête au cours des trois derniers exercices financiers.
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | |
|---|---|---|---|
| Cibles | 480 | 470 | 410 |
Le CSARS a relevé des indices montrant que le SCRS est au cœur d’un « changement de culture », qui tient à trois facteurs principaux : l’influence des partenaires étrangers proches du SCRS, les priorités et attentes du gouvernement du Canada ainsi que les réactions et les exigences des clients qui reçoivent et utilisent les rapports du SCRS.
Pour ce qui est du premier facteur, certains changements apportés aux produits, au moment où la DER passait au cœur du cycle du renseignement du Service, étaient modelés sur des services de renseignement étrangers qui présentaient certains défis. Les services de renseignement étrangers ne font pas de distinction entre le renseignement de sécurité et le renseignement étranger : ils se limitent à recueillir « des renseignements ». Pour le SCRS, cependant, la distinction entre les deux est un élément essentiel de son mandat. En imitant les services de renseignement étrangers et leurs produits, le SCRS court le risque de gommer les distinctions dans son mandat de collecte. Cela représente un changement de culture non seulement dans la production, mais aussi dans la collecte. Aussi le CSARS croit-il que, puisque le SCRS s’enquiert de pratiques exemplaires auprès de ses alliés, il devrait aussi s’adresser aux autres organismes canadiens de renseignement de sécurité.
En ce qui touche le deuxième facteur, les priorités et les attentes du gouvernement du Canada influent énormément aussi sur les priorités de collecte du SCRS. Il se peut qu’une exigence jugée hautement prioritaire par le gouvernement, en matière de renseignement, corresponde mal au mandat principal du SCRS. Cette situation risque d’amener le SCRS à axer de plus en plus la collecte sur les priorités plus vastes du gouvernement du Canada en matière de renseignement, ce qui pourrait aller à l’encontre de sa fonction principale.
Quant au troisième facteur – les réactions et les demandes des clients – la DER s’emploie depuis quelques années à élaborer une stratégie active, axée sur les réactions des clients, qui permet au SCRS de solliciter les opinions de ministères fédéraux. Une stratégie axée sur les clients est utile jusqu’à un certain point mais pourrait alourdir la demande à laquelle le SCRS doit répondre, car les renseignements sollicités ne sont pas tous de son ressort. En s’efforçant de répondre aux demandes des clients, le SCRS risque de recueillir et de produire des renseignements qui s’écartent de son mandat principal : le renseignement de sécurité.
Le nouveau rôle centralisé de la DER a été conçu de manière à atténuer certains défis ayant trait aux priorités grandissantes en matière de renseignement et aux demandes accrues de renseignements étrangers et de renseignements de sécurité, axés sur les clients, mais aussi à aider le SCRS dans ses opérations. Cependant, le CSARS craint que les efforts conjugués du SCRS pour imiter la structure des services de renseignement étrangers dans l’établissement et la diffusion de rapports et pour répondre aux priorités plus vastes du gouvernement du Canada en matière de renseignement, de même que le processus plus actif du SCRS axé sur les réactions des clients, pourraient faire perdre de vue l’objet premier de son mandat principal : le renseignement de sécurité.
B. Plaintes
Outre sa fonction de surveillance, le CSARS est investi de celle d’enquêter sur les plaintes présentées par des personnes ou des groupes à l’endroit du SCRS. Les types de plaintes visées par ses enquêtes sont décrits dans la Loi sur le SCRS et peuvent prendre diverses formes, dont deux sont plus fréquentes. En vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS, le CSARS enquête sur les plaintes qui concernent « des activités du Service ». Selon l’article 42, il enquête sur celles qui ont trait au refus d’habilitations de sécurité à des fonctionnaires ou à des fournisseurs du gouvernement fédéral. Beaucoup moins souvent, le CSARS fait enquête sur des renvois de la Commission canadienne des droits de la personne ou sur des rapports du Ministre concernant la Loi sur la citoyenneté.
Le processus relatif aux plaintes au CSARS
La première étape d’un dossier de plainte peut être la présentation d’une demande de renseignements au CSARS, soit par écrit, en personne ou par téléphone. Sur réception d’une plainte écrite, le personnel du CSARS informe le plaignant éventuel des exigences de la Loi sur le SCRS, afin de pouvoir ouvrir un dossier de plainte officiel.
Lorsqu’il reçoit une plainte officielle par écrit, le CSARS effectue un examen préliminaire. Celui-ci peut porter sur toute information que peut détenir le SCRS, à l’exception des documents confidentiels du Cabinet. Si la plainte ne satisfait pas à certaines exigences de la loi, le CSARS la déclare hors de sa compétence et n’ouvre pas d’enquête à ce sujet.
Si le CSARS détermine qu’il a compétence, il enquête sur la plainte lors d’une audience quasi judiciaire, présidée par un ou plusieurs de ses membres que secondent son personnel et son équipe de juristes en leur fournissant des avis concernant la procédure et les questions de fond.
Des rencontres peuvent être tenues avec les parties, avant l’audience, pour établir et arrêter les questions préliminaires de procédure, comme les allégations sur lesquelles faire enquête, la forme à donner à l’audience, l’identité et le nombre des témoins à citer, les documents à préparer en vue de l’audience ainsi que la date et l’endroit de celle-ci.
Le temps nécessaire à l’enquête et au règlement d’une plainte peut varier d’après divers facteurs, dont la complexité du dossier, la quantité de documents à examiner, le nombre de jours d’audience requis (tant en présence qu’en l’absence du plaignant) et la disponibilité des participants.
Selon la Loi sur le SCRS, les audiences du CSARS doivent être tenues « en secret ». Chacune des parties a le droit d’être représentée par un avocat et de formuler des observations à l’audience, mais aucune ne peut, de plein droit, être présente au moment où une autre personne expose ses observations au CSARS, ni y avoir accès ou les commenter.
Une partie peut demander une audience ex parte (en l’absence du plaignant et, peut-être, d’autres parties) au cours de laquelle elle présente des preuves qui, pour des raisons de sécurité nationale ou pour d’autres motifs que le CSARS juge valables, ne peuvent être révélées à l’autre partie ou à son avocat. Lors d’une telle audience, l’équipe de juristes du CSARS contre-interroge les témoins pour s’assurer que les preuves ont été bien vérifiées et sont fiables. Cela permet de fournir au membre-président du CSARS des données de fait complètes et exactes en tous points au sujet de la plainte.
Une fois clos le volet ex parte de l’audience, le CSARS détermine si l’essentiel de la preuve peut être dévoilé aux parties exclues. Le cas échéant, il prépare un résumé de la preuve et le leur présente, une fois celui-ci expurgé pour des raisons de sécurité nationale.
Après avoir terminé son enquête sur une plainte portée en vertu de l’article 41, le CSARS présente un rapport au directeur du SCRS et au ministre de la Sécurité publique ainsi qu’une version déclassifiée du rapport au plaignant. Dans le cas d’une plainte déposée en vertu de l’article 42, le CSARS remet aussi son rapport à l’administrateur général compétent.
Le tableau 1 expose l’état des diverses plaintes qui ont été présentées au CSARS au cours des trois derniers exercices financiers, y compris celles qui lui ont été adressées à tort, qui étaient hors de sa compétence ou qui ont été réglées à la suite d’une enquête sans audience (p. ex. par un examen administratif).
| 2009–2010 | 2010–2011 | 2011–2012 | |
|---|---|---|---|
| Reportées de l’exercice précédent | 22 | 31 | 16 |
| Nouvelles plaintes | 32 | 17 | 17 |
| Total | 54 | 48 | 33 |
| Dossiers réglésNote de fin de tableau † | 23 | 32 | 11 |
Critères de compétence du CSARS à examiner une plainte…
…en vertu de l’article 41
En vertu de l’article 41 de la Loi sur le SCRS, le CSARS est tenu de faire enquête sur les plaintes que « toute personne » peut porter contre « des activités du Service ». Pour que le CSARS fasse enquête, deux conditions doivent être remplies :
- le plaignant doit d’abord avoir présenté sa plainte par écrit au directeur du SCRS sans recevoir de réponse dans un délai raisonnable (environ 30 jours) ou, s’il en a reçu une, sans que cette réponse le satisfasse;
- le CSARS doit être convaincu que la plainte n’est pas frivole, vexatoire ou sans objet, ni entachée de mauvaise foi.
Le CSARS ne peut enquêter sur une plainte qui peut être réglée autrement, par une procédure de griefs en vertu de la Loi sur le SCRS ou de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
...en vertu de l’article 42
Quant aux habilitations de sécurité, le CSARS est tenu, selon l’article 42 de la Loi sur le SCRS, de faire enquête sur les plaintes présentées par :
- les personnes qui ne sont pas embauchées par le gouvernement fédéral à cause du refus d’une habilitation de sécurité;
- les fonctionnaires fédéraux qui sont renvoyés, rétrogradés ou mutés ou qui se voient refuser une mutation ou une promotion pour la même raison;
- les personnes qui se voient refuser un contrat pour la fourniture de biens ou de services au gouvernement, toujours pour le même motif.
Les plaintes semblables doivent être présentées dans les 30 jours du refus de l’habilitation de sécurité.
Le CSARS peut prolonger cette période si des raisons valables lui sont fournies.
Enquête du CSARS : Retard présumé à fournir une évaluation de sécurité
Le CSARS a fait enquête sur une plainte à l’égard d’un retard présumé du Service à fournir une évaluation de filtrage de sécurité à l’immigration dans le cadre d’une demande de résidence permanente au Canada. Le plaignant a allégué que ce retard lui avait occasionné des difficultés sur le plan tant financier que professionnel.
Dans son enquête, le CSARS a constaté que le Service avait mis plus de deux ans à traiter le dossier du plaignant. Il a également constaté que chacune des mesures prises par le SCRS pour traiter ce dossier était justifiée et que le plaignant n’avait pas été ciblé injustement. En fait, le dossier a été réglé dans le délai moyen de traitement des dossiers semblables. Cependant, le temps qu’il a fallu au Service pour terminer son évaluation de filtrage de sécurité à l’immigration du plaignant et fournir ses conseils à Citoyenneté et Immigration Canada n’était pas raisonnable. Le CSARS a constaté que le retard semblait systématique et, en conséquence, n’était pas causé par un acte illicite de la part du SCRS, mais qu’il résultait de la conjonction d’un surcroît de travail et d’un manque de ressources humaines au sein de l’unité qui était chargée de traiter le dossier du plaignant pendant la période visée par l’enquête.
Le CSARS encourage le Ministre à faire un suivi directement auprès du SCRS afin de discuter des moyens d’assurer l’attribution de ressources suffisantes pour éviter des retards déraisonnables à l’avenir.
Section 3 : Survol du CSARS
Composition du Comité
Le CSARS est présidé par l’honorable Chuck Strahl, C.P. Les autres membres du Comité sont l’honorable Frances Lankin, C.P., C.M., l’honorable Denis Losier, C.P., C.M., et l’honorable Philippe Couillard, C.P., M.D.
Personnel et organisation
Le CSARS jouit du soutien d’une directrice exécutive, Susan Pollak, et d’un effectif autorisé de 15 employés, en poste à Ottawa. Cet effectif comprend un directeur de la recherche, un avocat principal, un directeur des services généraux et d’autres professionnels et agents administratifs.
Le Comité dicte au personnel l’orientation à donner aux travaux de recherche et autres activités désignés prioritaires pour l’année. La marche des affaires courantes est confiée à la directrice exécutive qui s’enquiert au besoin de la ligne de conduite à tenir auprès du président, en sa qualité de premier dirigeant du CSARS.
Dans le cadre de leurs travaux suivis, le président et les membres ainsi que les cadres supérieurs du Comité prennent part régulièrement à des discussions avec la direction et le personnel du SCRS et d’autres membres de la collectivité du renseignement. À ces échanges se greffent des entretiens avec des universitaires et des experts du renseignement et de la sécurité et d’autres organismes compétents. Ces activités enrichissent les connaissances du CSARS au sujet des questions et débats qui entourent le paysage de la sécurité nationale au Canada.
Les membres et les cadres du Comité visitent aussi les bureaux régionaux du SCRS afin de comprendre et d’évaluer le travail courant des enquêteurs locaux. Ces visites leur fournissent l’occasion de se faire exposer les problèmes, difficultés et priorités propres à ces bureaux par les cadres régionaux du Service. Elles leur permettent aussi de faire valoir ce qui polarise les efforts et les préoccupations du CSARS.
Au chapitre des ressources humaines, le CSARS continue de gérer ses activités dans les limites des ressources qui lui sont octroyées. Ses principales dépenses ont trait au traitement de son personnel et à ses déplacements afin de participer aux audiences, aux exposés et aux activités de surveillance du Comité au Canada.
Le tableau 2 présente une ventilation des dépenses réelles et des prévisions de dépenses.
| 2011–2012 (prévisions) | 2011–2012 (réelles) | |
|---|---|---|
| Total | 2,84 | 2,57 |
| Personnel | 2,02 | 1,84 |
| Biens et services | 0,82 | 0,73 |
Activités du Comité
12–14 octobre 2011 : Le président du CSARS a siégé à un groupe d’experts sur la reddition de comptes des organismes de sécurité et de renseignement lors de la conférence annuelle tenue à Montréal par l’Institut canadien d’administration de la justice et intitulée : « Terrorisme, droit et démocratie : 10 ans après le 11 septembre ». La directrice exécutive et des cadres supérieurs du CSARS ont aussi assisté à la conférence.
8-10 novembre 2011 : Le président, la directrice exécutive et des cadres supérieurs se sont rendus à Londres, au Royaume-Uni, rencontrer des homologues britanniques et des représentants du gouvernement en vue de discuter de questions d’intérêt commun.
24 avril 2012 : La directrice exécutive a accepté l’invitation à faire un exposé sur l’importance de la reddition de comptes en matière de renseignement de sécurité lors d’une conférence de l’OTAN sur la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits de la personne dans les activités des services spéciaux, à Kiev, en Ukraine.
27–30 mai 2012 : Le CSARS a tenu la conférence internationale des organismes de surveillance du renseignement, de concert avec le Bureau du Commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications. Cette conférence, qui avait pour thème « consolider la démocratie par une surveillance efficace », a réuni à l’hôtel Château Laurier d’Ottawa des délégués de l’Australie, de la Belgique, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Norvège, de l’Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis. Elle présentait des groupes d’experts sur l’évolution du droit dans divers domaines : la surveillance et le contrôle, les médias comme moyen de surveillance/contrôle, la mobilisation de l’opinion publique et l’équilibre entre la sécurité nationale et les droits individuels. Parmi les conférenciers invités, on comptait le sénateur Hugh Segal, Mel Cappe (ancien greffier du Conseil privé), Jim Judd (ancien directeur du SCRS), David Walmsley (rédacteur en chef du Globe and Mail) et le juge Simon Noël, de la Cour fédérale.
Liste des recommandations du CSARS
Au cours de la période étudiée, l’exercice 2010–2011, le CSARS a formulé les recommandations qui suivent découlant des études effectuées et des plaintes visées par ses enquêtes.
|
Rapport |
Recommandations du CSARS |
|---|---|
|
Le rôle du SCRS à l’égard du Programme de protection des passagers |
Le CSARS recommande que le SCRS élabore sous peu un ensemble cohérent de critères visant à déterminer les désignations éventuelles, tout en étant conscient que ces critères pourront devoir être modifiés régulièrement au fil du programme. |
|
Le rôle du SCRS dans le processus d’attestation de danger pour la sécurité |
Le CSARS recommande que le SCRS entreprenne un examen complet, axé sur l’avenir, des décisions judiciaires pertinentes pour assurer une bonne compréhension de ce qu’elles impliquent pour le Service sur le plan des opérations, des processus et des ressources. |
|
Le rôle du SCRS dans une enquête sur la lutte contre la prolifération |
Le CSARS recommande qu’à l’avenir, les évaluations de risques devraient comporter une appréciation plus nuancée et complète des organismes partenaires pris isolément, s’il y a lieu. |
|
La radicalisation d’origine intérieure |
Le CSARS recommande que le SCRS élabore une nouvelle politique concernant l’échange d’informations sur des mineurs avec des partenaires étrangers ou qu’il modifie la politique existante sur l’échange d’informations de manière qu’elle reflète une sensibilité appropriée à l’égard des jeunes.
Pour assurer qu’une attention et une sensibilité appropriées soient portées aux renseignements recueillis et conservés sur des mineurs, le CSARS recommande que tous les rapports opérationnels contenant de tels renseignements portent une mention à cet effet. |
|
L’appui du SCRS à l’égard des dossiers nouveaux et des priorités du gouvernement du Canada en matière de renseignement |
Pour rendre plus efficace et plus durable la part jouée par le SCRS dans ces affaires, le CSARS lui recommande d’élaborer des procédures opérationnelles appropriées et des mécanismes visant à améliorer sa capacité opérationnelle et son expertise. |
|
Un poste du SCRS à l’étranger |
Le CSARS recommande que le SCRS adopte une pratique obligeant les agents de collecte à l’étranger à alerter les modules opérationnels lorsqu’une demande d’échange d’informations avec un partenaire étranger demeure sans suite, pour quelque motif que ce soit, de sorte que le rapport opérationnel puisse être modifié. |
|
Les relations du SCRS avec un partenaire étranger |
Le CSARS recommande que le SCRS élabore une politique et des orientations sur l’application pratique des assurances, indiquant par exemple le moment et la manière de les demander, sous quelle autorité le faire et le mode de consignation de ce processus dans les rapports opérationnels.
Le CSARS est d’avis que la politique sur les mises en garde aurait dû être revue depuis longtemps et, à cet égard, il recommande qu’une mise à jour de la politique soit effectuée de manière à refléter les pratiques et processus actuels d’échange d’informations avec les partenaires étrangers, et qu’elle soit achevée sans plus de retard. |
|
Élaboration et diffusion de produits du renseignement par le SCRS |
Le CSARS recommande que le SCRS établisse un moyen plus précis pour suivre ses activités de production afin de représenter de façon exacte la proportion des informations au titre de l’article 12 et de celles relevant de l’article 16.
Le CSARS craint que les efforts conjugués du SCRS pour imiter la structure des services de renseignement étrangers dans l’établissement et la diffusion de rapports et pour répondre aux priorités plus vastes du gouvernement du Canada en matière de renseignement, de même que le processus plus actif du SCRS axé sur les réactions des clients, pourraient faire perdre de vue l’objet premier de son mandat principal : le renseignement de sécurité. |
|
Retard présumé à fournir une évaluation de sécurité |
Le CSARS encourage le Ministre à faire un suivi directement auprès du SCRS afin de discuter des moyens d’assurer l’attribution de ressources suffisantes pour éviter des retards déraisonnables à l’avenir. |
- Date de modification :